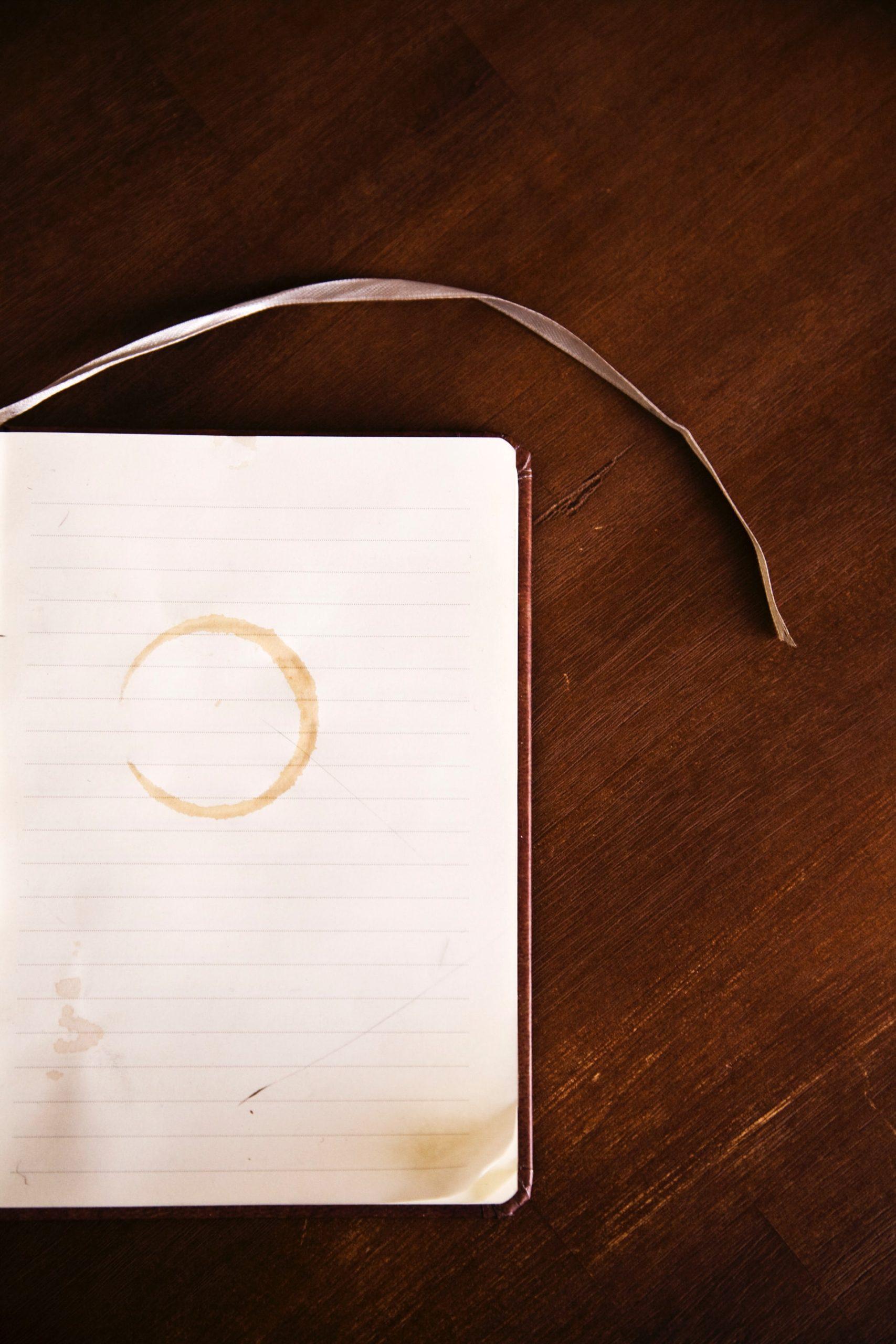Ça pue très fort, la mort.
Au point que le sens de l’odorat n’est plus requis pour le voir. La logique comptable à l’œuvre depuis des millénaires est en train d’atteindre le point où son exercice démentiel déssille les paupières. La puissance d’anéantissement qui préside à son exercice saute aux yeux, quand bien même la tentation de persister dans l’aveuglement se ferait aussi pressante que celle d’ouvrir cet œil capable d’écoute. Persister dans l’aveuglement ou ouvrir cet œil qui écoute est un choix dont il appartient à chacun de se débrouiller avec.
Croire que l’une ou l’autre de ces options serait la clé du salut est illusoire. Cela dit, il ne s’agit pas pour autant de deux options dont les effets seraient équivalents. A préciser que pour qu’un œil puisse écouter, il faut qu’il y ait quelque chose à entendre. Un œil qui écoute s’appuie sur ce qu’il ne voit pas, sur ce sur quoi il est aveugle ; un œil qui s’éveille à l’écoute commence par entendre depuis la rumeur du tohu-bohu : le monde d’images que tes yeux voient induisent ton psychisme — ta comprenette — à la méprise, au malentendu, au mal dit. Les chansons de Pascal Obispo, les bouquins de Houellebecq, les séries qui vendent à leur sponsor une page de publicité entre deux dialogues écrits avec les pieds, les Ducons-la-Joie qui ne veulent pas qu’on touche à leur poste mais qui brutalisent celles et ceux qui ne sont pas leurs potes, etc… , remplissent, avec des degrés divers dans les effets délétères de leur production, les mêmes fonctions : à savoir la participation, la contribution, l’invitation à persister dans l’erreur la mieux partagée : celle de se fier à la jouissance immédiate, triste et éphémère, que procure cette foire aux illusions, incarnée par ces écrans d’images, de sons et de mots creux, qui tend à annihiler la possibilité d’ouvrir cet œil qui écoute. Avec la conséquence suivante : l’anéantissement pour chacun de la possibilité de se rendre disponible à ce qui en soi est sauf et irréductible : la parole, le rêve, l’écoute, l’altérité, l’amour.
L’intelligence artificielle de Macron ou celle de Zemmour, le capitalisme, le néolibéralisme, l’invasion roboticonumérique, la barbe de Ben Laden, les joues lisses de Zuckerberg, les moustaches d’Hitler ou celles de Staline (ce ne sont pas tout à fait les mêmes moustaches, soit dit en passant, ça mériterait de revenir à ce qui les distingue quand bien même ce en quoi elles fascinent conduit grosso-merdo au même désastre), l’empire Gafamique, la teub d’un milliardaire dans l’espace…
Que cherche ce vilain petit monde ? Quelle est l’angoisse fondamentale qui préside à sa folie destructrice ? Une déduction faite du projet transhumaniste, déjà en germe dans le projet nazi : une angoisse de la mort telle, que la poursuite de ce fantasme vieux comme le monde, celui de tuer la mort, s’en trouve justifié — avec, par voie de conséquence, l’anéantissement de la vie.
Je ne suis vivant que parce que je vais mourir, ça doit être mes parents qui me l’ont dit quand j’étais petit. Ce vilain petit monde est à poil, même s’il se croit planqué sur son île bunkerisée, sur Neptune ou sur Jupiter, ou derrière ses milliards d’écrans et de dollars. Structurellement impuissant, malgré les moyens sans limites dont il dispose pour mener son entreprise de destruction, d’anéantissement et d’immortalité, à me dicter quoi que ce soit. Ni l’emploi de mon temps, ni mes choix, ni mes amours, ni mes amis, ni l’entretien de ma singularité et de mon altérité.
Il est cependant très capable, par une palette de moyens très large qui va du chômage au camp de concentration en passant par l’action de sa maltraitance quotidienne, de mettre un terme à ma vie, ce à quoi — la mort — il faut bien se résoudre : on doit tous y passer.
Perdre sa vie à la gagner ? Comme dirait Ribéry, la question, elle est vite répondue : non merci, je ne fais que passer. Je gagne ma vie chaque jour en allant aussi joyeusement que possible (ce n’est pas facile, loin de là) vers ma jolie mort.