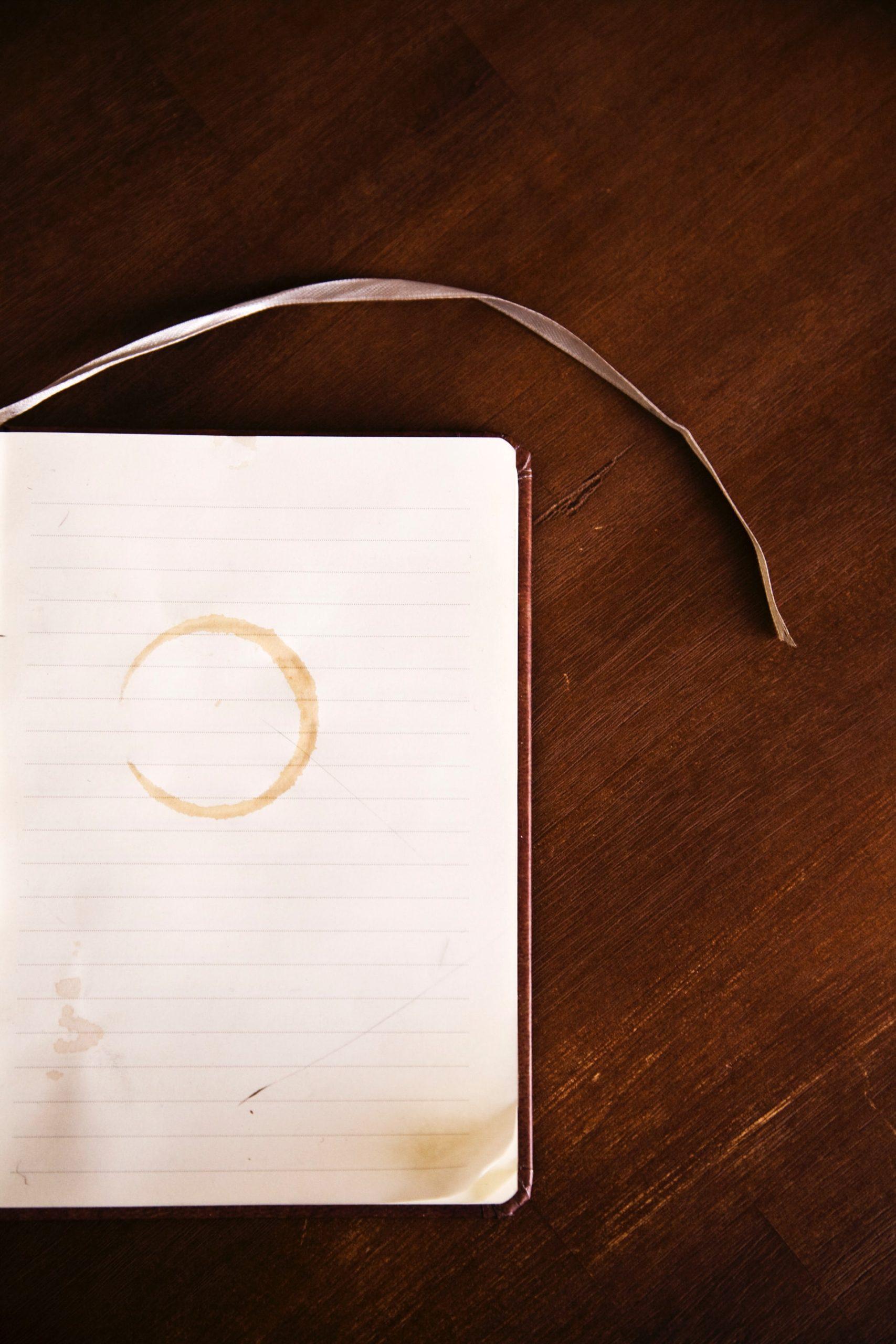
Ce que ne veulent pas savoir la théorie et la clinique analytiques — lacanienne, en particulier — réside dans ce qui semble être pour la psychanalyse un impossible structurel, quelque chose de quoi elle est forclose, à savoir un au-delà — et un en-deçà — du langage et de la lettre, correspondant au réel musical sur quoi s’étaye le sujet de l’inconscient : origine antérieure à l’expérience sensorielle des limites du corps que le sujet habite ; antérieure à celles du toucher, du goût, de l’odorat, et de la vue ; réel
musical des silences, des sons, du bruit, des voix, qu’il reçoit in-utero : réel de la sonate maternelle. Cette forclusion, très courante chez les psychanalystes — et pour cause : Freud et Lacan n’entendaient pas grand-chose à la musique, n’y avaient pas
de goût —, produit des effets très concrets dans la cure : tout se passe comme si l’analyste forclos de ce réel musical, attentif au signifié et au signifiant aussi bien qu’à la corporéité émanant de son analysant, ne pouvait entendre d’où s’énonce la détresse — et la demande qui lui correspond — du sujet. Prêtant une oreille qui se veut précise à l’extrême, rigoureuse jusqu’à
l’âpreté, au discours énoncé par l’analysant, systématisant jusqu’au mathème le primat du signifiant, il ne peut, ni ne veut, prêter son ouïe à ce qui dans le discours de son analysant s’offre à lui comme musique. Forclusion de l’analyste qui porte sur toute la gamme d’émotions — de faits sensibles pour le sujet, à quoi correspondent une demande, adressée à l’analyste — dont est capable la musique : lamento du fado ; souffrance sublimée en joie du blues ; swing « endieusé » du jazz ; régularité interne et certaine du reggae ; holistique de la musique indienne ; quête de sens, désabusée jusqu’au cynisme, du rap ; magie, euphorique, dionysiaque, de la musique africaine et de la musique klezmer ; couleurs spectaculaires et surcompensatoires de la musique pop ; diablerie excitée du rock ; défi agnostique (en mineur, chez Bach ou Haydn) ou marche victorieuse (en majeur, chez Mozart) de la musique classique ; joie sereine, désillusionnée, de la musique brésilienne ; bruit, écho du chaos, de la musique contemporaine ou industrielle ; états seconds, effets d’une toxicomanie auquel le malaise contemporain invite, de la techno et de l’électro ;
indifférence, comme un nihilisme qui s’ignore, de la musique d’ascenseur… Consonances signifiantes des rythmes, réel questionnant des mélodies, des harmonies et des voix. Le lieu d’où s’élance le sujet qui parle (du lieu topologique originel de sa
psychogénèse), d’où s’exprime la détresse et se formule la demande, demeure inaccessible à l’analyste forclos. En conséquence de quoi, la parole de l’analysant se heurte à la surdité absurde de l’analyste que sa foi exclusive en la lettre semble avoir privé de cœur : comme si le poème musical que cherchait à lui faire entendre l’analysant était à ce point angoissant pour lui qu’il lui fallait réduire la musique qu’il reçoit de son analysant à un pur signifié dont le signifiant littéral serait la clé. Ses interventions ne peuvent dès lors se réduire qu’à une production d’effets de sens, de mi-dires confinant à la malédiction, qui ne sont que les reliquats d’un dire de l’analysant (qui ne sait pas toujours bien ce qu’il dit, loin s’en faut : quelque chose cherche à se dire, difficilement ; et l’analyste va souligner cet écart entre la tentative d’énoncé et l’énonciation, souvent avec une rigoureuse
âpreté), d’un dire que l’analyste aura pris soin de décharner de la musique (musique qui correspond au « d’où » s’élance la demande, lieu de détresse) qui l’étaye. Ces effets de sens ne manqueront pas de transformer, pour
l’analysant, la réalité en une sorte de théâtre où il se fera l’acteur en quête des os à ronger — effets de sens, questions — que lui aura lancés son analyste, os qui ne correspondent pas à quoi que ce soit de la demande de
l’analysant, mais aux questions que lui pose — que se pose — son analyste. L’analysant se trouve dès lors chargé, au nom d’une éthique psychanalytique douteuse (« être dupe de la bonne façon », selon le précepte de Lacan. De deux choses l’une : soit on est dupe, auquel cas, on est innocent jusqu’à ce qu’une éventuelle prise de conscience se fasse jour ; soit on ne l’est pas. « Être dupe de la bonne façon » suppose une duperie toute relative, un mensonge donc, soutenu et répété, que l’analyste assume auprès de son analysant, aux risques et périls de ce dernier) qui se lave les mains de ce qu’elle ne veut pas savoir, d’aller résoudre, dans une réalité transformée en théâtre, les transferts non liquidés que son analyste entretient avec ses maîtres — Lacan en tête, à propos de qui l’analysant ne cessera pas, tant que n’aura pas chu pour lui le savoir qu’il prête à son analyste, de se demander
quand il sera bien là… La détresse et la demande de l’analysant demeurent quant à elles lettre morte ; alors qu’il quête dans son quotidien les réponses aux questions de son analyste pour lui en rendre compte (comme un chien rapporte la balle à son maître), la clé musicale de sa portée de notes demeure inouïe, comme la lettre volée d’Edgar Allan Poe demeure ignorée. Ce que Donald Winnicott a assumé du réel de la détresse du sujet avec son concept de « holding » — réel de détresse qu’il ne se refusa pas à
prendre en charge jusqu’au risque, à l’occasion, du contact physique avec certains de ses patients — en vue de réparer le lieu topologique où la sonate maternelle, quelqu’en soit le comment, a pu faire défaut pour la constitution de l’intégrité psychique du sujet, la plupart des psychanalystes, en particulier ceux qui se réclament de Lacan, en sont incapables pour des raisons structurelles — leur forclusion — qui leur appartiennent (je souligne). Leur éthique de silence n’est bien souvent que l’autre face de leur incapacité à entendre le silence de leurs analysants, quand celui-ci appelle à se faire entendre. Car ce silence-là n’est pas la monstration d’un impossible à dire monstrueux, dont l’analysant serait honteux, mais renvoie au silence de l’infans in-utero, d’où se reçoit le poème musical sur lequel s’étaye le sujet de l’inconscient. La musique reçue, grâce au silence de l’utérus, précède,
dans la psychogénèse du sujet, aussi bien le langage que les sens du toucher, du goût, de l’odorat, de la vue. Primauté du réel musical : l’inconscient n’est pas structuré comme un langage, mais comme un poème musical — auquel
le langage est subsumé.

